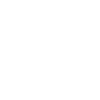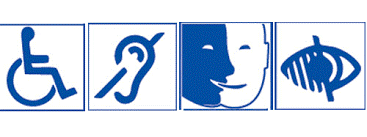Ville régénérative
Concevoir des villes résilientes et intégrées au vivant
Face aux défis de l’urbanisation intensive, du changement climatique et des inégalités socio-environnementales, la ville régénérative propose une approche nouvelle allant au-delà de la durabilité. Cette démarche, fondée sur la restauration des écosystèmes, la résilience des espaces urbains et l’inclusion sociale, implique un changement profond de perspective. Cette formation donne des éléments clés pour comprendre les interactions entre les échelles globale, territoriale et locale pour construire les villes de demain.
- Identifier les principes fondamentaux de la ville régénérative
- Appréhender les stratégies, procédures et outils permettant la mise en œuvre concrète de la conception régénératrice
- Découvrir des modèles inspirants de villes régénératives
Maîtriser les principes, méthodes et outils nécessaires pour concevoir des stratégies opérationnelles de régénération urbaine et piloter efficacement des démarches participatives
- Professionnels de l’urbanisme et de l’environnement (MOE) : architectes, urbanistes, écologues, paysagistes, ingénieurs, hydrologues, environnementalistes, programmistes, sociologues...
- Collectivités locales (MOA) : élus, techniciens territoriaux, gestionnaires...
- Acteurs du développement local : bureaux d’études, associations environnementales
Maîtriser les bases du droit de l'urbanisme
Comprendre la ville régénérative
- Urbanisme conscient, du dégénératif vers le régénératif
- Sobriété et efficacité énergétique
- Agriculture urbaine et souveraineté alimentaire
- Mobilités douces et infrastructures partagées
- Solutions basées sur la nature (SafN) pour restaurer les écosystèmes urbains
Partage d'expériences des participants sur leurs territoires respectifs
Fil rouge en illustration : le projet « Malgaches-Paradis » à Saint Laurent du Maroni
Appréhender la notion de limite en matière d'aménagement
- Reconnaissance et analyse des limites physiques (infrastructures, frontières, coupures urbaines) et des limites immatérielles (frontières d'usage, privé/public, identitaire)
- enjeux de ces limites dans la conception régénérative
- rôles des différents acteurs : politique, technique, population, privés, publics...
- Propositions d’amélioration basées sur des principes régénératifs
- du S au L, les conditions pour mettre en œuvre un projet régénératif
- la remise en questions des limites, une utopie ?
Atelier groupe : sur la base du projet fil rouge, chacun identifie et choisit une typologie de limite (privé/public, bâti/non-bâti...) puis exprime les idées d’évolution, en distinguant les aspects politiques, physiques, foncier, etc.
Coconstruire une vision régénérative - travail collaboratif sur des scénarios prospectifs
Phase 1 : Présentation du déroulement du jeu
Base du « projet » : ACOUA (Mayotte)
Phase 2 : Attribution des rôles
Chaque participant choisit un rôle différent de sa fonction (politique, MOE, MOA, habitant).
Le formateur affiche la liste des rôles dans le chat ou sur un document partagé.
Phase 3 : Débat sur les priorités de la ville
Le formateur décrit la ville (S/L) et ses défis (ex. : risques naturels, imperméabilisation, problèmes de mobilité, accessibilité au logement, assainissement, eau potable, contexte social et culturel...). Il exprime les évolutions espérées par les acteurs locaux.
Chaque joueur exprime ses priorités et propositions selon son rôle, en argumentant ses choix. Il propose une analyse rapide des avantages de son choix (ce que cela solutionne en rapport avec la régénération).
Une liste des priorités est écrite collectivement dans le chat ou sur le document partagé.
Phase 4 : Événements imprévus et ajustements
Le formateur annonce un ou des événements aléatoires (ex. : inondation, fermeture d’usine, mobilisation citoyenne).
Les participants doivent réagir en 5 minutes en adaptant leurs propositions.
Chacun exprime ses choix par un mot synthèse. En groupe, par l'animation du formateur, on établit une « liste » priorisée des actions proposées, une forme de liste stratégique d'actions dans l'espace et dans le temps.
Phase 5 : Restitution et débriefing
Synthèse des décisions prises.
Tour de table : quels apprentissages et points clés retenir ?
Discussion sur la mise en pratique réelle de ces concepts.
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme